






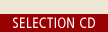




|
 |
| SELECTION CD |
05 avril 2025 |
 |
| Le coffret anniversaire Decca |
Le coffret du centenaire Decca

Igor Stravinski (1882-1971)
Le Sacre du printemps
100th anniversary collectors Edition
38 versions de l’œuvre étalées sur plus de soixante ans
20 CD Decca 478 3729

Si Sony a misé sur la sélection, Decca joue l’exhaustivité, en proposant un véritable objet de collection à travers ce gros coffret de 20 CD comprenant rien moins que 35 versions du Sacre, soit tout le fonds Universal (Deutsche Grammophon, Philips, Decca, Mercury, ASV et Club français du disque), auquel ont été adjointes trois versions pour piano à quatre mains (Ashkenazy-Gavrilov en tête), ainsi qu’une gravure historique du Concerto pour violon sous la direction de l’auteur.
A-t-on jamais imaginé plus bel hommage discographique pour fêter une œuvre aussi fondamentale dans l’Histoire de la musique ? Car bien au-delà de la quantité, l’opération permet de mesurer la qualité indéniable de la discographie du Sacre du printemps, admirablement servi au disque.
Monteux et Ansermet, tradition française
Loin d’être la version de trop de Monteux, sa dernière gravure (1956) avec l’Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire (ancien Orchestre de Paris) fait valoir de somptueuses couleurs françaises et des bois à l’acuité jubilatoire, ne cherchant en rien une homogénéité de groupe qui sera l’obsession de Boulez, et affiche au contraire fièrement ses sonorités préhistoriques, dans la veine du premier enregistrement d’Ansermet (1950) – sec, dur, impitoyable, d’une géniale austérité – en tout point supérieur au remake stéréo (1957) dont les bois passeront de l’acide au burlesque.
Sans la dimension analytique du chef suisse, Monteux refait en plus coloré, plus bigarré et plus clair son Sacre de Boston, avec le même mélange de finesse de coloris et de sauvagerie chorégraphique. L’introduction du Sacrifice, notamment, avec ses mixtures inouïes, jusqu’à ce solo de violon-flûte aux allures d’onde Martenot, est un trésor d’évocation ancestrale et primitive, malgré les fragilités d’une formation française dont la rigueur n’est pas la qualité première.
Dorati et Fricsay, Hongrois dévastateurs
Chef clé dans la discographie du Sacre du printemps, Dorati est célébré ici à travers ses trois enregistrements. Celui de 1959 avec Minneapolis pour Mercury, hallucinant, a longtemps compté parmi les fleurons du disque. Cette version supersonique de 29 minutes et des poussières avance avec la puissance d’un tsunami et des timbres hyper individualisés, transcendés par une prise de son phénoménale de relief et de présence. Une version immense.
Le coffret offre comme pépite la première version Dorati-Minneapolis, gravée en mono en 1953, un rien moins propulsée dans son tempo, mais avec un relief quasi similaire et des timbales encore plus présentes, jusqu’à une Évocation des ancêtres crucifiante et une Danse sacrale étourdissante de violence, qui font qu’on a du mal à choisir entre les deux.
De retour au Sacre au terme de sa carrière, le vieux chef gravait une dernière fois la partition en 1981 à Detroit, dans une approche bien aussi musclée mais beaucoup plus large, moins tranchante, moins exceptionnelle de timbres, avec une poigne tout de même impressionnante mais moins de singularité discographique.
L’autre Hongrois du coffret, Ferenc Fricsay, tire plutôt l’œuvre vers les blocs monochromes de la Musique pour cordes percussions et célesta de Bartók, avec ses timbales noires, ses timbres secs et cassants, et sa motorique obsessionnelle dans des tempi médians, avec un geste nettement moins cinglant et une prise de son mono assez standard (1954)
Ozawa-Boston, le premier pas idéal
Par rapport à son premier enregistrement avec Chicago, pourtant très proche quant au minutage, la gravure d’Ozawa à Boston (1979) joue la sérénité et un superbe équilibre apollinien, dans des textures très allégées et un geste chorégraphique qui nettoie les tympans après des dizaines d’approches plus musclées.
Presque joyeux, envisageant le sacrifice de manière positive, voici selon nous la version idéale pour aborder l’œuvre – une Danse sacrale à la sécheresse, au phrasé court juste comme il faut. Le classique des classiques de la discographie, dénué de la moindre vulgarité, et au final l’une des versions les plus attachantes qui soient.
Le démiurge Karajan
On sait les réserves émises par le compositeur devant l’introspection de la première version Karajan (1963). Et pourtant, on aimerait entendre plus souvent un tel mélange de beauté plastique, de cordes en acier trempé (Danse des adolescentes) et de solos de bois fusant de telle manière. Dès l’introduction, une touffeur tropicale prend à la gorge et installe un vrai climat de profusion chaotique. Et partout, on sent la poigne – un Jeu du rapt parmi les mieux tenus dans la vitesse – et le magnétisme d’un authentique maître de la baguette.
On préfère d’ailleurs assez nettement cette première version à son remake (1975-1977), toujours avec les Berliner, qui mérite les réserves adressées par Stravinski à la version précédente. Ici, la « barbarie de salon » cède le pas au pur hédonisme, et même si ici ou là , tel accent est mieux asséné, on préfère la spontanéité et les contours sonores de la première version, y compris dans des parties lentes cette fois étrangement fébriles, capiteuses mais moins riches en évocation de la création du monde.
|  |
|
Mehta et Bernstein, jeune loup et vieux lion
Depuis longtemps indisponible, la première version du jeune Mehta (1969) refait surface. On regrette seulement que le Los Angeles Philharmonic sonne fébrile devant une approche aussi punchy, et peine à conserver sa stabilité face aux vrombissements de la battue extraordinairement pugnace du chef indien, qui fait d’emblée sentir que ce sont les passages rythmiques à bride abattue qui l’intéressent le plus.
Si l’on reconnaît volontiers que les deux premières versions de Bernstein avaient quelque chose de plus immédiatement sauvage et un impact sonore à nul autre pareil, on se demande finalement si l’on ne préfère pas dans le fond son ultime Sacre avec le Philharmonique d’Israël (1982) présent dans ce coffret Decca – le plus lent de toute cette confrontation, avec ses quasi 37 minutes.
Une vision beaucoup plus tenue au niveau instrumental, une réalisation plus précise, aux plages de violence, à l’impact physique mieux maîtrisés, renforcés par une prise de son idéalement sèche qui en désempèse les contours, ne gardant que le muscle de cette approche remarquable, décantée ici où là dans des passages lents typiques du Bernstein dernière manière, très étiré.
Abbado et Davis, hors pistes grinçant
Ce coffret anniversaire est aussi l’occasion de redécouvrir l’unique gravure de Claudio Abbado à la tête du LSO (1975), l’une des versions les plus atypiques du Sacre : entre raucités moussorgskiennes et expressionnisme façon Seconde École de Vienne, le chef italien livre une lecture au vitriol, aux timbres caustiques, cauchemar psychologique sans le moindre effet de masse, où chaque saillie est rigoureusement assénée là où elle fera le plus mal. Un Sacre en rien aimable, loin de l’image habituelle du maestro affable, souple et élégant que l’on connaît aujourd’hui.
Toujours avec le LSO, la première version de Colin Davis (1963), âpre, cassante, dégraissée, souvent anguleuse, jamais impressionnante dans la masse mais d’un climat tendu, coupant, retient elle aussi immédiatement l’attention.
Tilson Thomas, figure de proue
Des caractéristiques que l’on admirera au centuple dans l’enregistrement exceptionnel de Tilson-Thomas avec Boston (1972), l’un des piliers de la discographie : vision en noir et blanc, austère, calibrée au cordeau, où chaque accent trouve sa juste place (les percussions, et notamment un timbalier parfait), dans une forme de quadrature du cercle. On cherchera en vain pareille réussite à la fois sur le plan vertical et horizontal, notamment dans un Jeu des cités rivales grisant, dans une Danse de la terre inouïe de détails, dans une Danse sacrale magistrale d’un bout à l’autre. Version du peloton de tête, sans aucun doute.
Chailly, vainqueur de Boulez par KO
Le hasard de la chronologie veut que se trouvent sur le mĂŞme CD les versions Chailly (1985) et Boulez (1991), toutes deux avec Cleveland. Et lĂ oĂą le chef italien, qui, avec son interprĂ©tation taillĂ©e comme un diamant brut, sans une once de lourdeur, claire comme une eau pure, galbĂ©e Ă la perfection, d’un sens de la narration qui captive d’un bout Ă l’autre, ressort parmi les grands vainqueurs de cette confrontation discographique (en rappelant parfois rien moins qu’un Karel Ančerl), Boulez Ă©tale au grand jour les limites d’une approche purement abstraite et gĂ©omĂ©trique, dĂ©shumanisĂ©e, poussĂ©e Ă son extrĂ©mitĂ© conceptuelle, et de surcroĂ®t contredite par des solos de cordes ultra-vibrĂ©s, en nĂ©gation du geste global – introduction du Sacrifice.
L’OVNI Gergiev et l’outsider Levine
Chacun appréciera selon sa sensibilité la version extra-terrestre de Valery Gergiev (1999), véritable OVNI discographique, complètement nihiliste, tantôt nébuleuse et indéchiffrable (Introduction) tantôt surexcitée et grasse (Danse de la terre), souvent imprévisible et à l’occasion d’une brutalité, d’une grossièreté (les dégueulandi de cuivres dans les Rondes printanières, la toute fin de la Danse sacrale) qui suscitent bien des interrogations. Un mélange assez inimitable d’intuitions géniales et de mauvais goût fini, mais au final certainement l’une des versions les plus authentiquement russes du Sacre.
Quitte à oser une lecture franchement fracassante, on se tournera vers la version de James Levine et l’Orchestre du MET (1992), grosse surprise du coffret, qui attrape la partition à bras le corps pour en extraire tout le potentiel sonore possible, dans une approche en hymne percussif. Et même si cette violence reste au final assez extérieure, au moins le chef américain ose-t-il un festival d’accents paroxystiques qui vaut mieux que l’avancée à hue et à dia de l’électron libre Gergiev.
Salonen et Dudamel, la tĂŞte et les jambes
Profitons aussi de l’occasion pour dire notre scepticisme devant la version ultra cotée de Salonen-Los Angeles (2009), qui nous a toujours laissé de marbre, alors qu’en concert, le chef finlandais demeure l’un des meilleurs défenseurs du Sacre. Version niant tout aspect incantatoire au profit d’un exercice totalement conceptuel, aux timbres fusionnés jusqu’à l’indistinct, à la froideur rédhibitoire, soit le total opposé de la première version du chef, alors dans l’exact excès inverse. Précisons aussi que la prise de son globalisante de ce disque décoré comme un maréchal soviétique en accuse ce que nous considérons comme des limites.
On prend dans le fond nettement plus de plaisir à la récente version Dudamel (2010), physique, cravachée mais jamais caricaturale, d’un sens du mouvement assez grisant, donnant parfois l’impression que son Orchestre des Jeunes du Venezuela entier se démène dans une samba endiablée, en une impressionnante apothéose du rythme (Danse sacrale), enivrante mais ne franchissant jamais la limite du too much.
|  |
|
Mais aussi…
On passera beaucoup plus vite sur certaines gravures qui n’apportent rien à la discographie : Rattle-Orchestre des jeunes anglais, sans colonne vertébrale, et avec une prise de son indigne ; Dutoit-Montréal, très lisse, sans personnalité ; Leinsdorf-London Philharmonic, trop épais, trop gras ; tout l’opposé de Chung-Radio France, transparent, sans consistance ; Bychkov-Orchestre de Paris, boueux ; Ashkenazy-DSO Berlin, un peu épais, malgré un excellent timbalier (et dieu sait si cela compte dans le Sacre !) ; Davis-Amsterdam, très inférieur à la première version avec le LSO ; ou encore les versions Solti et Haitink, solides, professionnelles mais sans transcendance.
Et l’on guettera non sans intérêt la singularité de versions comme celle de Rudolf Albert avec l’Orchestre des Cento soli (1956), très française de ton et moderne de facture dans son genre, celle de Van Beinum avec Amsterdam (1946), ou encore Maazel-Vienne (1974), très inégale dans les passages de masse mais d’une qualité instrumentale assez étonnante.
Au final, un grand Coup de cœur tout de même pour ce gros coffret, afin de récompenser tant de richesses au service d’une partition inépuisable, et qui un siècle après sa naissance n’a sans doute pas encore révélé tous ses secrets.

Signalons que pour les amateurs du Sacre moins fortunés, Decca publie en parallèle un coffret hommage beaucoup plus light de 4 CD avec les versions Monteux-Conservatoire, Dorati-Detroit, Chailly-Cleveland, Boulez-Cleveland II, Gergiev-Mariinski et Salonen-Los Angeles, plus un documentaire audio de Jon Tolansky sur l’histoire de l’œuvre, entièrement en anglais (sans traduction dans le livret) faisant intervenir chorégraphes, chefs d’orchestre et témoins de la création. Un bonus intéressant mais en rien fondamental, car souvent trop linéaire dans son explication de l’intrigue.
|  |
|
Yannick MILLON
Le coffret anniversaire SonyLe coffret anniversaire DeccaNouvelles parutionsÀ l’heure des comptes…
|  |
|



