Abbado Mahler
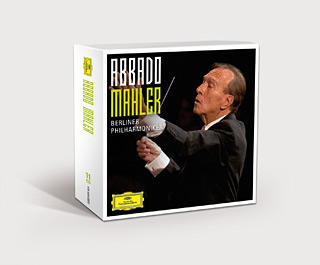

Gustav Mahler (1860-1911)
Symphonies n° 1-9
Eteri Gvazava (soprano Sy2), Anna Larsson (alto, Sy2, 3), Renée Fleming (soprano Sy4), Sylvia McNair, Cheryl Studer (sopranos), Rosemarie Lang, Anne Sofie von Otter (contraltos), Peter Seiffert (ténor), Bryn Terfel (baryton), Jan-Hendrick Rootering (basse, Sy8)
Orfeón Donostiarra (Sy2), London Symphony Chorus, City of Birmingham Symphony Youth Chorus (Sy3), Rundfunkchor Berlin, Prag Philharmonic Choir, Tölzer Knabenchor (Sy8)
Lucerne Festival Orchestra (Sy2)
Berliner Philharmoniker
direction : Claudio Abbado
Enregistrements : Philharmonie, Berlin, 1989-2005; Royal Festival Hall, Londres, 1999 ; KKL, Lucerne, 2003
11 CD Deutsche Grammophon 479 3204
On sait l’importance qu’a prise Mahler dans le cœur de répertoire d’Abbado au fil des ans, et la progression fulgurante de ses interprétations mahlériennes, transcendées dans sa dernière décennie par une lutte incessante contre la maladie. On avait toujours regretté jusqu’ici que le disque reflète de manière insuffisante quel immense chef mahlérien il était.
Le problème reste que le chef italien n’a jamais gravé de véritable intégrale. Ses premiers essais (Symphonies 1, 2, 5, 6 et 7) avec Chicago (1976-1984), ont été interrompus par de nouvelles explorations (3, 4, 9, Adagio 10) ou remake (2) avec les Wiener (1980-1992), et le seul véritable coffret des Mahler d’Abbado à ce jour était celui mélangeant les premières sources de Chicago et Vienne avec quelques gravures des premières années à Berlin (1989-1994) : coffret « 10 Symphonies » avec la répartition suivante : Berlin (1, 5, 8), Vienne (2, 3, 4, 9, Adagio 10), Chicago (6, 7). Soit une intégrale regroupant des gravures étalées sur plus de quinze ans, alors que le style du chef avait déjà évolué.
La nouvelle solution proposée par Deutsche Grammophon semble a priori plus unitaire, s’en tenant aux enregistrements berlinois préexistants (1, 5 et 8, de 1989 à 1994) ainsi qu’aux nouvelles moutures berlinoises sur le vif parues séparément dans les années 2000 (3, 4, 6, 7, 9), et intégrant la Résurrection de 2003 avec Lucerne. À l’arrivée, même si la solution semble préférable en théorie, on s’interroge sur la cohérence de parutions étalées entre la Titan de 1989 et la Quatrième de 2005.
À notre sens, la seule alternative aurait été de publier les bandes sonores des vidéos données à Lucerne entre 2003 et 2011, où chaque année, le chef italien présentait un maillon de l’intégrale des symphonies, abandonnant juste l’idée en 2012 de donner la Huitième avec laquelle il ne se sentait pas à l’aise, et de lui substituer celle, berlinoise, de 1994.
Autre source de frustration, ce nouveau coffret ne propose pas d’Adagio de la Dixième Symphonie, inexistant dans la discographie du chef sur la période choisie. Malédiction, quand tu nous tiens… Reste à passer au crible la somme rassemblée ici.
Plusieurs constatations s’imposent. Tout d’abord, seule la Neuvième (1999) trône au panthéon de la discographie, comme nous l’avons récemment rappelé dans le coffret 100 Great Symphonies. Au rayon des réussites, citons la Huitième, composition la plus positive du corpus, conduite avec une très belle ampleur et des couleurs lumineuses.
Et une distribution de premier choix, inégalable sur le papier, un peu moins idéale à l’épreuve du concert (certains aigus de Studer, le chant trop peu canalisé de Terfel) mais parmi les meilleures dont le disque ait disposé dans une œuvre que le chant irrigue de bout en bout.
Succès aussi pour les gravures les plus anciennes : Première Symphonie (1989) fort bien menée, rubato subtil, art des transitions à nul autre pareil, soli instrumentaux de toute beauté, qu’on retrouve dans la Cinquième (1994), sublime dans ses trois premiers mouvements, un cran en dessous dans l’Adagietto, un rien corseté, et, comme chez Kubelik, dans un Finale trop retenu.
Malgré une prise de son étrange, l’exécution captée par la BBC de la Troisième possède un certain nombre d’atouts. D’abord une conception très sombre, comme perdue d’avance, du héros mahlérien en butte aux éléments hostiles (un premier mouvement oscillant sans cesse entre abattement et envie d’en découdre), qui ne trouve le repos – et encore – que dans l’immense Adagio final, conduit sur les sommets après des mouvements centraux angoissés, avec une Anna Larsson à son meilleur.
Une prise de son globalisante, ouatée et un peu sourde, qu’on retrouvera à moindre degré dans la Sixième Symphonie qui reste à nos oreilles la réévaluation majeure de ce coffret (à l’interversion près des mouvements centraux, que nous exécrons).
Une Tragique où manquent souvent l’acuité des attaques instrumentales dans le détail et une plus grande lisibilité de la polyphonie, mais où les instants critiques sont rendus avec une violence presque insoutenable – certains ostinatos de timbales, les coups de marteaux du Finale, mouvement le plus exceptionnel, dont l’issue laisse hébété.
À côté d’une belle Deuxième Symphonie lucernoise (2003), moyennement chantée et rarement transcendante mais d’une tenue globale enviable, les maillons faibles restent une Septième brouillonne, enlisée dans la capiteuse beauté sonore des Berliner, manquant de cette myriade de détails, d’accents, et de micro-événements à même de former un vrai kaléidoscope sonore, et une Quatrième Symphonie en tout point inférieure à la gravure viennoise avec Federica Von Stade.
La souplesse du geste, la gestion des transitions ne sont pas en cause, mais un curieux sentiment d’affadissement guette à chaque mesure, malgré l’écrin sonore majestueux. Et l’on reste très fâché contre Madame Fleming, timbre sublime passant son Lied à minauder, à faire ralentir le chef tant elle est incapable de déclamer l’allemand à une vitesse convenable.
Faute d’une somme homogène, il faudra donc se contenter de quelques joyaux au sein de cette intégrale. En attendant qu’un jour peut-être Lucerne édite les bandes audio de ses vidéos…
|  |
|



